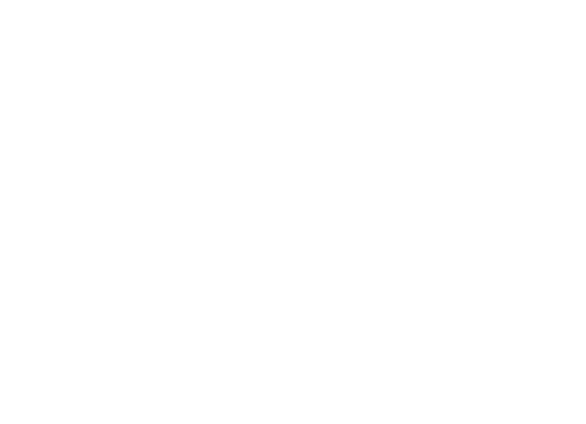|
Écrit par : Henry Corbin
Titre : L'Imagination créatrice
dans le soufisme d'Ibn 'Arabi
Date de parution : 2006
Éditeur : Entrelacs
|
Henry Corbin, L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabi, Entrelacs, Paris, 2006, 398 pp. Dans cet ouvrage, Henry Corbin nous présente Ibn ‘Arabi (1165-1240), l’une de des figures les plus importantes du soufisme. Le célèbre auteur andalou des Fosus al hikam (les Gemmes de la sagesse) et des Futuhât al Makiyya (les Illuminations de la Mekke) marque, d’après Corbin, le début d’une renaissance de la philosophie traditionnelle en occident arabe. Le lecteur trouvera dans cette étude une large présentation des mystiques arabes de l’époque ainsi qu’un exposé complet de la pensée d’Ibn ‘Arabi et en particulier, de sa manière d’envisager le mundus imaginalis (le monde des images). En voici quelques passages, aussi originaux qu’intéressants : Oui, « c’est mieux ainsi », que la sophia ne soit pas enseignée dans nos écoles et universités, infectées elles aussi par ce savoir de masse, par cette déferlante de savoirs insignifiants… C’est « en marge » que la vérité se transmet et fructifie : talents et deniers ne doivent pas être placés dans une entreprise en faillite ! [Gilbert Durand] (p. 7) Entre l’univers appréhensible par la pure perception intellectuelle (l’univers des Intelligences chérubiniques) et l’univers perceptible par les sens, il existe un monde intermédiaire, celui des Idées-Images, des figues archétypes, des corps subtils, de la « matière immatérielle ». Monde aussi réel et objectif, consistant et subsistant, que l’univers intelligible et l’univers sensible, univers intermédiaire « où le spirituel prend corps et où le corps devient spirituel », constitué d’une matière et d’une étendue réelles, quoique à l’état subtil et immatériel par rapport à la matière sensible et corruptible. C’est cet univers dont l’imagination active est l’organe. (p. 26) Certes, Averroès a été inspiré par l’idée du discernement des esprits : il y a les gens auxquels s’adresse l’apparence de la lettre, le zâhir, et il y a ceux qui sont aptes à comprendre le sens caché, le bâtin. Il sait que l’on déchaînerait les psychoses et les catastrophes sociales, en livrant aux premiers ce que seuls les seconds peuvent comprendre. Tout cela est proche de la « discipline de l’arcane » pratiquée dans le shî’isme ismaélien, et de l’idée du ta’wîl professée dans le soufisme (p. 35) Le symbole annonce un autre plan de conscience que l’évidence rationnelle ; il est le « chiffre » d’un mystère, le seul moyen de dire ce qui ne peut être appréhendé autrement ; il n’est jamais « expliqué » une fois pour toutes, mais toujours à déchiffrer de nouveau, de même qu’une partition musicale n’est jamais déchiffrée une fois pour toutes, mais appelle une exécution toujours nouvelle. (pp. 35-36) Toute apparence, tout exotérique (zâhir) a un ésotérique (bâtin) ; le Livre « descendu du ciel », le Qorân, limité à la lettre apparente, périt dans l’opacité et la servitude de la religion légalitaire. Il faut en faire éclore, dans la transparence des profondeurs, le sens ésotérique. (p. 48) Lorsqu’il a reconnu son guide invisible, il arrive que le mystique désire retracer sa propre isnâd, c’est-à-dire montrer la « chaine de transmission » aboutissant à sa personne, attester l’ascendance spirituelle dont il se réclame à travers les générations humaines sur terre. Il ne fait rien d’autre, ni rien de moins, que de désigner nominativement les esprits à la famille desquels il a conscience d’appartenir. (p. 56) On souhaite l’avènement d’un humanisme intégral, un état des choses où il soit possible de sortir des horizons de nos programmes classiques, sans faire figure de « spécialiste » qui étonne et fatigue l’honnête homme par ses allusions incompréhensibles. Nous avons une idée courante du Moyen Age ; tout le monde sait qu’il y a eu une philosophie « arabe » et une science « arabe », sans pressentir qu’il y a eu beaucoup plus, et que dans ce « beaucoup plus », il y a une somme d’expérience humaine dont la méconnaissance n’est pas étrangère aux désespérantes difficultés de l’heure. C’est qu’il n’y a pas de dialogue possible à moins de problèmes communs et d’un vocabulaire commun ; et cette communauté de problèmes et de vocabulaire ne se forme pas subitement sous la pression de faits matériels, mais mûrit lentement par une participation commune aux suprêmes questions que s’est posée l’humanité. On dira peut-être qu’un Ibn ‘Arabi et ses disciples, voire que le shi’îsme lui-même, ne représentent qu’une petite minorité au sein de la grande masse de l’Islam. Sans doute, mais en serions-nous dès maintenant arrivés au point de ne pouvoir apprécier l’ « énergie spirituelle » qu’en termes de statistiques ? (p. 57) C’est bien à Tunis, certes, que certain soir, retiré seul en un oratoire de la Grande Mosquée, il [Ibn ‘Arabi] compose une poésie qu’il ne communique à personne ; il se garde même de la mettre par écrit, tout en enregistrant dans sa mémoire le jour et l’heure de son inspiration. Mais voici que quelques mois plus tard, à Séville, un jeune homme qu’il ne connaît pas s’approche de lui et lui en récite les strophes. Bouleversé, Ibn ‘Arabi lui demande qui en est l’auteur. Et l’autre de répondre : Mohammad Ibn ‘Arabi. (p. 68) Nous considérons en lui [Khezr] ici essentiellement le maître spirituel invisible, réservé à ceux qui sont appelés à une affiliation directe au monde divin sans aucun intermédiaire, c’est-à-dire sans attache justificative avec une succession historique de shaykh en shaykh […]. (p. 75) « Je ne suis ni un prophète (nabî), ni un Envoyé (rasûl) ; je suis simplement un héritier, quelqu’un qui laboure en ensemence le champ de sa vie future. » [Ibn ‘Arabi] (p. 93) « En effet, tout auteur écrit sous l’autorité de son libre arbitre, quoique l’on dise que sa liberté est subordonnée au Décret divin, ou sous l’inspiration de la science qu’il possède comme étant sa spécialité… En revanche, l’auteur qui écrit sous la dictée de l’inspiration divine, enregistre souvent des choses qui sont sans relation (apparente) avec la matière du chapitre qu’il est en train de traiter ; elles apparaîtront au lecteur profane comme une interpolation incohérente, bien que selon moi elles appartiennent à l’âme même de ce chapitre, même si c’est en vertu d’une raison que les autres ignorent. » [Ibn ‘Arabi] (p. 95) Mais le fait qui domine le christianisme et qui ressortit à la question posée ici, c’est qu’avec la condamnation du mouvement montaniste au IIe siècle, s’est trouvée close désormais, du moins pour et par la Grande Eglise, non seulement toute possibilité d’une révélation prophétique nouvelle dispensée par les Anges, mais aussi toute initiative d’une herméneutique prophétique. Désormais la Grande Eglise se substitue à l’inspiration prophétique individuelle ; (p. 103) C’est pourquoi il convient d’attacher une grande importance aux pages où Ibn ‘Arabi distingue entre Allâh comme Dieu en général, et le Rabb comme le seigneur particulier, personnalisé en une relation individuée et indivise avec son vassal d’amour. (p. 115) Pour que le cri Dieu est mort laissât les êtres en proie à l’abîme, il fallait que depuis longtemps fût aboli le mystère de la Croix de Lumière. Ni l’indignation pieuse ni la joie cynique n’y peuvent rien changer. Il n’est qu’une seule réponse, celle-là même que Sophia, émergeant de la nuit, murmurait à l’oreille du pèlerin pensif circumambulant autour de la Ka’ba : Serais-tu donc toi-même déjà mort ? Le secret, auquel initient Ibn ‘Arabi et les siens, achemine ceux que le cri a ébranlés jusqu’au fond de leur être, à reconnaître quel dieu est mort et qui sont les morts. Le reconnaître, c’est comprendre le secret du tombeau vide. (p. 117) La notion d’un Dieu que les événements humains et les sentiments de l’homme atteignent et affectent et qui y réagit de façon toujours très personnelle, bref, l’idée qu’il existe un pathos divin dans tous les sens de ce mot (affection, émotion, passion), conduisait le chercheur à parler de ce pathos comme d’une catégorie sui generis. (p. 128) L’étymologie qu’il lui (à Ibn ‘Arabi) est arrivé de proposer pour le nom divin Al-lâh projette la lueur d’éclair sur le chemin que nous tentons de parcourir. Malgré les réticences de la grammaire arabe sur ce point, elle fait venir le mot ilâh de la racine wlh, laquelle comporte le sens d’être triste, accablé de tristesse, soupirer vers, fuir craintivement vers… (p. 132) Mais dans la terminologie propre à Ibn ‘Arabi, Al-lâh est le nom qui désigne l’Essence divine qualifiée et revêtue de l’ensemble de ses attributs, tandis qu’Al Rabb, le Seigneur, c’est le divin personnifié et particularisé dans l’un de ses attributs (d’où les Noms divins désignés comme autant de « seigneurs », arbâb). (p. 141) Ce que son iconographie mentale (d’Ibn ‘Arabi) lui représente dans la personne d’Abraham qui pourvoit au service des trois Anges siégeant pour le repas mystique, c’est le ministère qui incombe par excellence au fidèle d’Amour. C’est nourrir Dieu ou nourrir son Ange, de ses créatures, et c’est aussi bien nourrir celles-ci de ce Dieu. (p. 149) Aussi convient-il de distinguer avec Ibn ‘Arabi, trois sortes d’amour qui sont trois modes d’être : a) Il y a un amour divin (hibb illâhi), qui est d’une part l’amour du Créateur pour la créature en laquelle il se crée, c’est-à-dire qui suscite la forme où il se révèle, - et d’autre part l’amour de cette créature pour son Créateur, qui alors n’est rien d’autre que le désir du Dieu révélé dans la créature, aspirant à revenir à soi-même, après avoir aspiré, comme Dieu caché, à être connu dans la créature, - c’est l’éternel dialogue de la syzygie divino-humaine ; b) il y a un amour spirituel (hibb rûhânî), dont le siège est dans la créature toujours à la quête de l’être dont elle découvre en elle l’Image : c’est, dans la créature, l’amour qui n’a d’autre souci, but et volonté, que de satisfaire à l’Aimé, à ce que celui-ci veut faire de et par son fidèle ; c) et il y a l’amour naturel (hibb tabî’î), celui qui veut posséder et qui recherche la satisfaction de ses propres désirs, sans se soucier de l’agrément de l’Aimé. « Et telle est hélas !, dit Ibn ‘Arabi, la manière dont la plupart des gens d’aujourd’hui comprennent l’amour. (p. 166) « L’Amant divin est Esprit sans corps ; l’amant physique pur et simple est un corps sans esprit ; l’amant spirituel, c’est-à-dire l’amant physique, possède esprit et corps. » [Ibn ‘Arabi] (p. 174) [A propos de l’idée d’ « Incarnation sociale » du sociologue contemporain Soloview :] C’est là, je crois bien, une expression qui resterait inintelligible pour un disciple d’Ibn ‘Arabi ou de Jalâl Rûmî, - de même hélas ! qu’il est si difficile pour nous d’établir notre pensée au plan théophanique, - sans doute parce qu’il nous faut d’abord vaincre une habitude de penser enracinée par des siècles de philosophie et de théologie rationalisantes, et découvrir que la totalité de notre être, ce n’est pas seulement cette partie que nous appelons notre personne, car cette totalité inclut également une autre personne, une contrepartie transcendante qui nous demeure invisible, ce qu’Ibn ‘Arabi désigne comme notre « individualité éternelle » - notre « Nom Divin », - ce que le vieil Iran désignait comme Fravarti. Pour en éprouver la présence, il n’est pas d’autre lieu ni d’autre preuve que d’en subir l’attirance, en une sympatheia qu’exprime si parfaitement à sa manière la prière de l’héliotrope. N’attendons pas, en effet, que cet invisible nous soit prouvé objectivement pour entrer en dialogue avec lui. C’est notre dialogue qui est à soi-même sa preuve, car c’est l’a priori de notre être. (p. 188) « Bien-aimé ! Tant de fois je t’ai appelé, et tu ne m’as pas entendu. Tant de fois me suis-je à toi montré, et tu ne m’as pas vu. Tant de fois me suis-je fait douce effluve, et tu ne m’as pas senti, nourriture savoureuse, et tu ne m’as pas goûté. Pourquoi ne peux-tu m’atteindre, à travers les objets que tu palpes, ou me respirer à travers les senteurs ? Pourquoi ne me vois-tu pas ? Pourquoi ne m’entends-tu pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour toi mes délices surpassent toutes les autres délices, et le plaisir que je te procure, dépasse tous les autres plaisirs. Pour toi je suis préférable à tous les autres biens, je suis la Beauté, je suis la Grâce. Aime-moi, aime-moi seul. Perds-toi en moi, en moi seul. Attache-toi à moi, nul n’est plus intime que moi. Les autres t’aiment pour eux-mêmes, moi je t’aime pour toi. Et toi, tu t’enfuis loin de moi. » [Ibn ‘Arabi] (p. 190) Comme l’observait déjà Paracelse, à la différence de l’Imaginatio vera, la fantaisie (Phantasey) est un jeu de la pensée, sans fondement dans la nature, est n’est que « la pierre angulaire des fous ». (p. 193) Or, une double possibilité caractérise cette Imagination, pour autant qu’elle ne peut révéler le Caché qu’en le voilant encore. Elle peut être un voile, un voile se chargeant d’une opacité telle qu’elle nous asservisse et nous prenne au piège des idolâtries. Mais le voile peut s’alléger en une transparence croissante, car il n’a été instauré que pour que le contemplatif réalise par lui la connaissance de l’être tel qu’il est, c’est-à-dire la connaissance qui délivre, parce qu’elle est gnose de salut. (p. 202) L’Imagination est le « lieu d’apparition » des êtres spirituels, Anges et Esprits, qui y revêtent la figure et la forme de leur « corps d’apparition » ; (p. 204) De nombreux soufis professent que l’être divin s’épiphanise au cœur de chaque fidèle selon l’aptitude de ce cœur, c’est-à-dire prend chaque fois la Forme qui correspond à l’exigence et à la réceptivité que mesure cette aptitude. Il semble que pour Ibn ‘Arabi, une explication inverse de ce « kathénothéisme mystique » vaille de préférence quand il s’agit du gnostique (‘Arif). Ce n’est pas le cœur qui donne sa « couleur » à la Forme qu’il reçoit, mais inversement le cœur du gnostique « se colore » à chaque instant de la couleur, c’est-à-dire de la modalité de la Forme sous laquelle l’Être Divin s’épiphanise à lui. (p. 210) Plus encore, Ibn ‘Arabi fait allusion à une mystérieuse entraide spirituelle entre les vivants et les morts, c’est-à-dire entre les vivants de ce monde et les vivants des autres mondes. En effet, en ce monde même, par rencontre et conjonction mystique dans le monde intermédiaire (barzakh), il y a des spirituels qui peuvent venir en aide à certains de leurs frères en gnose en dénouant des liens restés secrets ; et en les instruisant de ce qui leur était caché, ils les aident à s’élever de degré en degré. (p. 220) Grâce à elle [la science de l’Imagination] vient à exister l’invraisemblable, ce que la raison récuse, et avant tout, par exemple, le fait que l’Être Nécessaire dont la pure Essence est incompatible avec toute forme, soit manifesté cependant sous une forme appartenant à la « Présence Imaginative ». Elle a en propre ce pouvoir de faire exister l’impossible, et la Prière mettra en œuvre ce pouvoir. (pp. 230-231) « Notre shaykh Ibn ‘Arabi avait le pouvoir de rencontrer l’esprit de n’importe quel prophète ou saint disparu de ce monde, soit en le faisant descendre au plan de ce monde et en le contemplant dans un corps d’apparition (surât mithâlîya) semblable à la forme sensible de sa personne, soit en faisant qu’il lui apparaisse dans ses rêves, soit en se déliant lui-même de son corps matériel pour s’élever à la rencontre de l’esprit. » [Sadroddîn Qonyawî, disciple de Ibn ‘Arabi] (p. 237) L’Être Divin a besoin de son fidèle pour se manifester ; réciproquement, ce dernier a besoin de lui pour être investi de l’existence. (p. 268) Ibn ‘Arabi est en train d’accomplir ses circumambulations autour de la Ka’ba, et voici que devant la Pierre Noire, il rencontre l’être mystérieux qu’il reconnaît et qu’il désigne comme « le Jouvenceau évanescent, le Parlant-Silencieux, celui qui n’est ni vivant ni mort, le composé-simple, l’enveloppé-enveloppant », autant de termes accumulés (avec réminiscences alchimiques) pour signifier la coincidentia oppositorum. À ce moment, le visionnaire a un doute : « Ce processionnal ne serait-il autre chose que la Prière rituelle d’un vivant autour d’un cadavre (la Ka’ba) ? » « Regarde, lui dit le Jouvenceau mystique, le secret du Temple avant qu’il s’échappe. » Et le visionnaire voit soudain le Temple de pierre devenir un être vivant. Il comprend quel est le rang spirituel de son Compagnon ; il baise sa main droite ; il veut devenir son disciple, apprendre de lui tous les secrets ; il n’enseignera pas autre chose. Mais celui-ci ne parle que par symboles ; il n’a d’autre éloquence que celle des énigmes. Et sur un signe mystérieux de reconnaissance, le visionnaire est submergé sous une telle puissance d’amour qu’il perd conscience. Quand il revient à lui, son Compagnon lui dévoile : « Je suis la Connaissance, je suis ce qui connaît et je suis ce qui est connu. » […] Le récit que fait le visionnaire à son confident et sur son ordre, c’est le récit de sa Quête, c’est-à-dire en bref de quelle expérience intérieure est éclose l’intuition foncière de la théosophie d’Ibn ‘Arabi. Cette Quête, c’est ce que représentent les circumambulations autour du Temple du « cœur », c’est-à-dire autour le mystère de l’Essence divine. […] Le dénouement est là : « Entre avec moi dans le Temple » ordonne finalement le Jouvenceau mystique. (pp. 290-291) Là même, nous pouvons saisir combien nous sommes imaginativement et spirituellement désarmés, par comparaison avec les Spirituels dont nous venons d’évoquer les certitudes au cours de ces pages. Ce que nous éprouvons comme une hantise du Néant, ou comme un consentement à un non-être sur lequel nous n’avons aucun pouvoir, eux-mêmes l’éprouvaient comme une manifestation du Courroux divin, le courroux de l’Aimé mystique. (pp. 292-293) |
Achat, Vente, Expertise de livres rares, anciens, épuisés, d'occasion et neufs spécialisés. La Librairie Arca s'inscrit dans la lignée des librairies traditionnelles.
Les visites à la librairie se font uniquement sur rendez-vous, qui seront pris de préférence par e-mail en utilisant ce formulaire ou par telephone au +32 (0)479474542
Nous cherchons en permanence pour achat des livres rares en lot ou à la pièce. N’hésitez pas à nous contacter pour une expertise gratuite.
Nous cherchons en permanence pour achat des livres rares en lot ou à la pièce. N’hésitez pas à nous contacter pour une expertise gratuite.