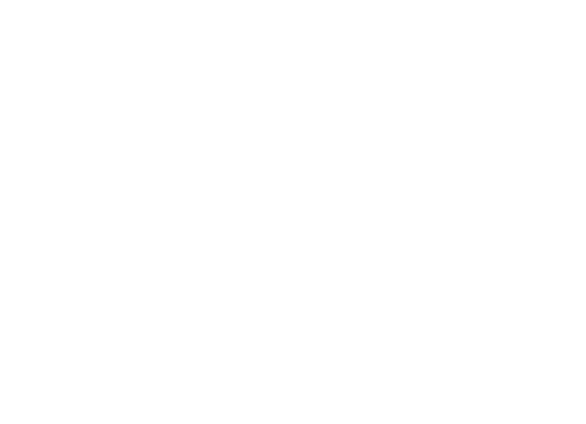|
Écrit par : Gérard Dorn -
Caroline Thuysbaert (trad.)
Titre : La Clef de toute la
philosophie chimistique
et commentaires sur trois
traités de Paracelse
Date de parution : 2014
Éditeur : Beya
 |
Gérard Dorn, La Clef de toute la philosophie chimistique et commentaires sur trois traités de Paracelse, Grez-Doiceau, Beya, 2014. Gérard Dorn (c. 1530-1584) était non seulement un traducteur et défenseur du célèbre Paracelse (1493-1541), mais aussi un auteur hermétique, un philosophe et un alchymiste de première importance. « Un très grand nombre de choses se cachent à présent de nous, qui étaient très familières à nos anciens Pères ». Pourquoi ? Parce que ce qu’on appelle un peu improprement les sciences occultes sont, en réalité, les sciences de l’occulte, c’est-à-dire la connaissance de ce qui est caché aux yeux charnels. Les lecteurs attentifs et sincèrement désireux de s’enquérir de la lumière de la nature se délecteront de ces traités, traduits ici pour la première fois en français : - La Clef de toute la philosophie chimistique ; - Commentaires sur L’Aurore des philosophes, sur Le Trésor de tous les trésors, et sur L’Économie minérale de Théophraste Paracelse. Voici quelques perles glanées au cours de notre lecture de ces Traités : Par l’étude, on acquiert la connaissance des choses. L’amour suit la connaissance. L’assiduité est donnée par le désir ou la délectation. La fréquentation donne l’expérience ; celle-ci la vertu et celle-là la puissance. Cette dernière parfait l’œuvre admirable dans la nature des choses, décrite ci-après. (pp. 15-16) L’artifice chimistique repose surtout sur trois points : le lieu, l’instrument et l’opération. Le lieu est double : celui des fourneaux et celui des vases qui contiennent la matière même. L’instrument lui aussi est double : le feu corrompant et le feu engendrant. L’opération, à son tour, est double : la solution et la coagulation. (p. 31) En effet, les semblables sont attirés par leurs semblables s’ils ne sont pas entravés ; le spiritus désire, de par sa propre nature, être libéré des liens du corps et retourner à son origine ou être uni à son semblable. (pp. 46-47) Beaucoup de choses, certes, sont venues à la lumière en notre siècle, qui furent insoupçonnées des hommes des temps passés ; de même, un très grand nombre de choses se cachent à présent de nous, qui étaient très familières à nos anciens Pères. Qu’est-ce qui ne tombe pas dans l’oubli par l’injure du temps et l’apathie des hommes ? La chose elle-même ne dépérit pas pour autant avec son souvenir. Après être assez longtemps demeurée ensevelie pour les gens à cette époque, elle émerge alors pour eux en notre siècle ou pour d’autres, selon le commandement de Dieu dans le cœur duquel reposent depuis l’éternité, avec sa sagesse, tous les arts louables et bons. Le Dieu Tout-Puissant distribue ses dons à qui il veut, et les ôte aux ingrats qui en abusent. N’en doutons pas : Dieu, par son Saint-Esprit, a révélé aux anciens Pères une certaine médecine leur permettant de se préserver de la corruption de la chair ; [il l’a] surtout [révélée] à ceux avec lesquels il a parlé et conclu une alliance. Mais la vaine soif d’être sages par eux-mêmes amena les hommes à chercher le salut par eux-mêmes, et ailleurs que là où réside le salut et la rédemption ; elle aveugla leur mens qui fut menée dans un labyrinthe. (pp. 57-58) On dit que la mens est bien composée, toutes les fois que l’animus est uni à l’anima d’un lien tel qu’il soit capable de mettre un frein aux appétits du corps. On comprend qu’il y a une bonne disposition du corps lorsqu’il est moins sujet à ses appétits corrompus ; elle est excellente lorsqu’il a acquis un meilleur tempérament de ses parties composantes. Alors, il recherche moins ce qui lui est propre, et il devient plus obéissant à la mens. Tout ce que le corps désire est corrompu ; mais il ne peut rien poursuivre sinon par les facultés de l’anima qui est son moteur. Celle-ci met simplement en mouvement, sans conception de bien ou de mal. Le corps subit un tel mouvement et, à cause de sa nature corrompue, il cherche à l’exécuter en vue du mal, si l’animus, qui ne conseille que le bien, ne s’y oppose pas. L’anima se situe donc entre le bien et le mal, et elle a une capacité propre de choisir le bien par le bien et le mal par le mal. Un tel mal ne se fait que lorsque le bien abandonne devant la résistance continuelle que fait l’anima, attirée par le corps, à l’attraction de l’animus mû par le bien. On peut désigner à juste titre cette résistance du nom d’obstination du mal contre le spiritus conseillant tout ce qui est bon. (p. 66) À nouveau, l’animus et le corps opposés en nombres sont des contraires, qu’on ne peut jamais conjoindre que par l’intermédiaire de l’anima qui participe de chacun de ces deux ennemis. Mais puisque l’un des extrêmes est parfait et l’autre imparfait, si le mouvement part d’abord du parfait, il transite par le milieu pour aller vers la perfection de l’imparfait, et inversement. Pour cette raison, Dieu a tout fondé à partir de Trois pour qu’ils s’unissent en Un. Il est en effet lui-même l’auteur de la paix et de l’union. Le Deux et le Un sont ennemis. Qu’on rejette le binaire pour que le ternaire puisse s’unir au Un, ce qu’on a expliqué plus largement dans la Clef; je n’en redirai pas plus ici. L’animus est égal pour tous, alors que la mens ne l’est pas. Très rares sont ceux qui possèdent une anima conjointe à l’animus ; nombreux sont ceux qui participent plus ou moins de la mens ; très nombreux, ceux qui, ayant le culte du corps dans l’anima et de cette dernière dans le corps, ne reconnaissent pas l’animus ; ceux-ci n’ont pas de mens, mais de la folie. (p. 68) Bref, le sage dominera les astres, alors que l’insensé leur est non seulement soumis à eux, mais aussi aux choses inférieures et à toutes les tribulations, quelles qu’elles soient. Est sage celui qui, ayant atteint la mens, la cultive ; est insensé, par contre, celui qui chérit son corps dans l’anima ou son anima dans le corps, en négligeant l’animus, ce qui est confirmé par le Verbe de Dieu : « Celui qui chérit son anima (entends : dans le corps) la perdra, et celui qui la hait (dans le sens susdit) la garde pour l’éternité » (Jean, XII, 25). On dit que celui qui poursuit ses appétits dépravés aime son anima dans le corps. En revanche, celui qui ne les recherche pas, tout en se délectant de pensées vaines, semble aimer le corps dans son anima. Celui qui bride les appétits du corps hait son anima dans le corps, et celui qui repousse les spéculations vaines hait le corps dans l’anima. (p. 70) J’en viens à l’anatomie du corps. Je dis qu’une bonne disposition du corps est nécessaire en vue de la vraie spéculation, et cela va de soi. En effet, à cause de sa propre nature corrompue, le corps alourdit l’anima, et l’empêche de pouvoir percevoir les actions du spiritus. La nature a donné à certains d’être plus aptes que les autres à réaliser cette séparation : ceux auxquels on n’a, par accident lors de leur formation, ajouté absolument aucune corruption (ou une petite seulement) à la corruption naturelle. (p. 71) Ce serait bel et bien une grande folie, de la part des hommes, de demander du pain à Dieu tout en refusant de labourer et de semer. Ce n’en serait pas une moins grande de désirer et d’espérer la mens sans montrer la moindre diligence à l’acquérir ; mais la folie serait totale si on était ignare au point de penser pouvoir l’acquérir uniquement par son propre travail, sans avoir imploré au préalable la grâce de Dieu. (p. 74) Il y a, latente dans le corps humain, une certaine substance métaphysique, connue de très peu de gens, qui n’a absolument pas besoin de médicament, mais qui est elle-même un médicament non corrompu. Mais comme elle est écrasée par les corruptions des corps physiques, et qu’elle est empêchée d’exercer ses actions de perfectionnement, les philosophes ont su, par une inspiration divine, que cette vertu et vigueur céleste pouvait être libérée de ses entraves, non par son contraire, comme l’enseigne la médecine physique, mais par son semblable. (p. 75) « Transmutez-vous, dit-elle [la vérité], transmutez-vous de pierres mortes en pierres philosophiques vivantes. Moi, je suis la vraie médecine qui corrige et transmue ce qui n’est plus en ce qui était avant la corruption (et dans un [état] bien meilleur), et ce qui n’est pas en ce qui doit être. Me voici aux portes de votre conscience, je frappe nuit et jour, et vous ne m’ouvrez pas ? Malgré tout, j’attends, douce, et je ne vous quitte pas pleine de colère. Je supporte patiemment vos injures, désirant vous amener à elle par la patience, en vous y exhortant. Revenez, revenez plus souvent, vous qui cherchez la sagesse, et procurez-vous gratuitement (non pour de l’or ni pour de l’argent ; encore moins par vos labeurs personnels) ce qui vous est offert par surcroît. » Voix sonore, suave et agréable aux oreilles des philosophes ! Ô source inépuisable de richesses pour ceux qui ont soif de vérité et de justice ! Ô consolation à l’imperfection de ceux qui sont désolés ! Que cherchez-vous de plus, mortels anxieux ? Pourquoi, misérables, tourmentez-vous vos animus de soucis infinis ? Quelle est cette démence qui vous aveugle, je vous le demande ? En effet, tout ce que vous cherchez hors de vous et non chez vous, se trouve en vous, et non hors de vous. C’est précisément le défaut habituel du vulgaire de mépriser ce qui lui est propre et toujours aspirer à ce qui appartient à autrui. Nous possédons ici en particulier par appropriation, car de nous-mêmes nous n’avons rien de bon ; si nous pouvons avoir quelque chose de bon, nous reconnaissons l’avoir reçu de celui seul qui est bon. Par contre, tout ce que nous possédons de mauvais, nous nous le sommes appropriés de nous-mêmes à partir du mal étranger, par désobéissance. L’homme n’a donc rien personnellement de lui-même, sauf le mal qu’il possède ; ce qu’il possède de bon [vient] du bien, et non de lui-même, mais il le possède en propre par attribution provenant du bien, lorsqu’il le reçoit cependant. La vie, lumière des hommes, luit en nous, obscurément, il est vrai, comme dans des ténèbres. Il faut la quêter non hors de nous, mais en nous, et la demander non à nous-mêmes, mais à celui à qui elle appartient. Ce dernier l’a plantée en nous, pour que nous voyions le luminaire dans le luminaire de celui qui habite la lumière inaccessible, et qu’en cela, nous surpassions toutes ses autres créatures, nous qui sommes rendus semblables à lui, pour la raison qu’il nous aura donné une étincelle de son luminaire. Il ne faut donc pas chercher la vérité en nous, mais dans l’image de Dieu, qui est en nous. (pp. 78-79) Personne ne pourra connaître le Créateur mieux que par sa créature, comme un artisan est connu par son œuvre. (p. 86) La vraie connaissance ne voit pas le jour avant que l’anima (comparant les choses durables avec les éphémères, celles de la vie autant que celles de la mort) ne choisisse de s’unir à l’animus, désirant davantage être attirée par lui que par le corps. C’est bien de cette connaissance-là que naît la mens et que s’amorce la séparation volontaire du corps, lorsque l’anima, constatant d’une part la laideur et la mort du corps, d’autre part la supériorité et la félicité perpétuelle de l’animus, désire se lier à cette [félicité] (le souffle divin en disposant ainsi), en négligeant totalement l’autre, afin de ne plus rechercher que ce qu’il voit, c’est-à-dire ce que Dieu lui a réservé pour son salut et sa gloire. Le corps est forcé de condescendre à l’union déjà réalisée entre les deux autres. Voilà l’admirable transmutation des philosophes, du corps en spiritus et de ce dernier en corps, au sujet de laquelle les sages nous ont laissé ce dicton : « rends le fixe volatil et le volatil fixe, ce par quoi tu auras notre magistère ». Comprends cela de la manière suivante : d’un corps rebelle, fais quelque chose de maniable, qui devienne, par la supériorité de l’animus s’accordant avec l’anima, un corps très constant, capable de résister à tous les examens. En effet, l’or est éprouvé par le feu qui réprouve tout ce qui n’est pas or. (pp. 88-89) De cet homme, demeurant encore en excellentissime état avant la chute, Dieu sépara la femme, os de ses os et chair de sa chair (cf. Genèse, II, 23), pour qu’ils s’unissent plus solidement que les autres animaux. On ne dit « unir » que pour des choses qui, du Un, avaient été séparées, sinon on dit seulement « conjoindre ». Donc, ce que le Un ne pouvait engendrer en soi-même, il devait le faire avec son autre moitié. La génération humaine doit être révérée plus que les autres, pour la raison qu’elle se produit entre deux qui étaient Un au départ et qui redeviennent Un par mariage divin, comme en atteste l’Écriture : « ils seront deux en une seule chair » (cf. Ephésiens, V, 31). Chacun quittera son père et sa mère à cause de l’autre et s’attachera à sa seconde moitié. Il ne faut pas envisager cela autrement que comme deux parties inséparables d’un seul corps, le mari de la femme et la femme du mari. Lorsque nous les verrons se comporter différemment, nous jugerons qu’ils ne sont pas unis, mais seulement conjoints, sans amour véritable, et en vue d’un profit honteux, ou plutôt de l’assouvissement d’un appétit illicite ; lorsque ce feu se sera refroidi, tout se refroidira à l’instant. (p. 92) Spiritus : ‘Allons donc, mon anima et mon corps, levez-vous maintenant ; suivez votre animus. Montons sur cette montagne élevée qui se trouve en face de nous. De son sommet, je vous montrerai cette double voie dont a parlé Pythagore au travers d’un voile et sans lumière. Nos yeux sont ouverts, et dès lors, le Soleil de piété et de justice brille devant nous ; avec lui comme guide, nous ne pouvons pas nous écarter de la voie de la vérité. Tournez d’abord vos yeux à droite, pour qu’ils ne voient pas la vanité avant d’avoir perçu la sapience’. (pp. 93-94) Philosophie. Qu’est la philosophie ?
Spiritus. C’est l’amour de la sagesse.
Ph. Qu’est la sagesse ?
S. C’est la sapience suprême de la vérité de toute chose.
Ph. Qu’est l’amour ?
S. C’est un désir insatiable de vérité connue. (p. 101)
Avant la chute d’Adam, il n’existait ni voie large de gauche ni vallée de misère, mais partout et pour tous, s’ouvrait l’accès à ces lieux très heureux. Après la première désobéissance de l’homme, le Seigneur a resserré cette voie très large en sentier très étroit et très ardu (comme vous le voyez). À son entrée, il a placé un ange chérubin tenant dans sa main une épée à double tranchant pour bien écarter tout le monde de l’entrée de l’heureuse patrie. Se détournant d’ici à cause du péché de leur premier parent, les fils d’Adam se sont construit une voie large à gauche, celle que vous avez évitée. Longtemps après, le Dieu Excellent Très-Grand est entré dans les secrets de ses secrets. Là, en raison de la pitié de l’amour et malgré les accusations de la justice, il conclut d’arracher le glaive de sa colère des mains de l’ange pour le suspendre à un arbre, et de lui substituer un hameçon en or à trois dents. Ainsi, l’ire de Dieu fut changée en amour, tout en respectant la justice. Avant cet événement, ce fleuve n’était pas comme à présent rassemblé en lui-même, mais avant la chute, il était répandu de manière égale par tout le globe terrestre, comme de la rosée. Après la chute, par contre, il retourna là d’où il était venu. Finalement, lorsque la paix et la justice se sont embrassées, l’eau de la grâce est descendue plus abondamment, en émanant d’en haut et en baignant à présent le monde entier. Ceux qui tournent à gauche, voyant en partie le glaive suspendu dans l’arbre et connaissant son histoire, passent leur chemin, trop embrigadés qu’ils sont dans le monde. D’autres le voient mais négligent de s’enquérir de son efficacité, d’autres encore ne le voient pas ni n’auraient voulu le voir. Tous ces gens dirigent leur pérégrination droit vers la vallée, sauf les quelques-uns qui sont ramenés au mont Sion grâce aux hameçons de la résipiscence ou de la pénitence. C’est maintenant, en notre siècle (qui est celui de la grâce), que le glaive a été transformé en notre Christ sauveur, monté sur l’arbre de la croix pour nos péchés. Tout cela indique les temps des lois de la nature et de la grâce divine ensuite. (pp. 102-103) À vingt-et-un ans accomplis, une grande partie arrive à un carrefour où il faut choisir ; la course de tous est retardée par l’hameçon de la « zone de pêche » du Seigneur par l’intermédiaire d’un ange. Mais la plupart se glissent en-dessous de l’hameçon, d’autres sautent au-dessus, et une très grande partie, alors que pendant ce temps quelques rares sont, eux, tirés, s’échappe entre l’hameçon et l’entrée en fuyant la voie du salut. Ce sont tous ceux qui s’efforcent d’échapper à cette « zone de pêche » et qui entrent dans le monde sans aucun frein. Notre Seigneur, Dieu de miséricorde, permet à la plupart d’entre eux, abusés par les délices et les voluptés mondaines, de tomber dans la pauvreté, qui permet de les ramener vers la première voie de résipiscence. Hélas ! c’est totalement inutile : le genre humain a le réflexe inné de résister à Dieu, et passe son temps à chercher, de son propre chef, les moyens d’échapper aux lacets qu’il s’est imposés lui-même, sans demander l’aide à celui seul dont dépend le don de toute miséricorde. En voici la conséquence : du côté gauche du chemin, ils se sont érigé un immense atelier où ils exercent toute sorte de fonctions. Dans cette maison règne l’activité : elle accueille tout le monde, sauf les fainéants et les paresseux. D’un côté se trouvent les officines littéraires de toutes les études, où se rassemblent ceux qui avaient abandonné les lettres par insouciance. Ils se rendent généralement dans des ateliers manuels installés en face : on y expérimente ce que les plus sages ont jadis confié à l’écrit. Ainsi, les gens inexpérimentés ne se laisseront plus entraîner, comme avant, par la lettre seule, dans des opinions fallacieuses. Ceux qui ont exercé le commerce pour leur perte et ceux qui, appliqués aux métiers manuels, sont tombés dans la pauvreté rêvent jour et nuit d’objets de nouvelles formes ou d’objets inouïs. Les marchands les exposent pour de l’argent devant [d’autres] marchands, les mécaniciens partout devant tous, pour résorber leurs pertes et pour parvenir ensuite à une situation plus rentable. Après l’avoir obtenue, ils se retirent de l’activité et se rendent dans la deuxième région du monde : ils traversent le pont de l’infirmité, devant lequel la deuxième « zone de pêche » du Seigneur s’efforce de ramener les brebis perdues à la véritable bergerie ; très peu de brebis entrent dans la voie de résipiscence. Toutes les autres franchissent le pont avec obstination et font usage des biens engendrés par leur travail avec plus de liberté qu’avant. Mais puisque le bon Dieu voudrait les faire revenir en arrière, il permet que des infirmités prennent possession d’eux. Une fois encore, cherchant le remède tout seuls, comme avant, ils affluent vers un gigantesque hôpital, construit également à gauche, où règne la médecine. Là, il y a une foule de pharmaciens, de chirurgiens et de physiciens ; chacun y exerce sa propre fonction. Ayant recouvré la santé, ils s’en vont non pas plus riches comme avant, mais moins riches. La plupart d’entre eux traversent, malgré la « zone de pêche » du Seigneur, le pont de la vieillesse ; seul l’un ou l’autre emprunte la dernière voie dite de la pénitence. Lorsqu’on est arrivé à la troisième région du monde, on ne peut voir que des vieillards au dos courbé, des visages ridés, des claudications, on n’entend que des lamentations, des soupirs, et un tas d’autres ennuis de ce genre. Chacun garde ses propres actions, jusqu’à son arrivée au dernier hospice, celui de la mort. Là, un hôte très sévère, dont la main n’épargne personne, lance de son arc mortifère, l’aiguillon de la séparation du corps et de l’anima. (pp. 106-107) Si le corps et le cœur de l’homme semés en terre, c’est-à-dire devenus terrestres, n’ont pas été mortifiés et ne sont pas morts, et s’ils n’ont pas recueilli le grain, Verbe de Dieu, et s’ils ne l’ont pas converti pour leur utilité, édification ou plutôt multiplication ; alors il demeure tout seul et ne portera pas de fruit. Ou encore [une interprétation] plus chrétienne : si le grain n’a pas été conjoint au corps mort par union, ils demeurent tous les deux séparés, sans fruit. (p. 121) La vertu des choses est la vérité de chaque chose ; la vérité est l’efficacité connue par expérience ; l’efficacité est l’influence céleste. Tout ce qui n’est pas du ciel ne peut être dit vertu, mais en est un faux simulacre. (p. 122) C’est pour cette raison qu’on dit que la foi provient de l’ouïe, car ce qu’on voit n’est pas la foi, mais une science certaine par démonstrations oculaires. L’Écriture Sainte en rend témoignage : « Tu as cru parce que tu as vu. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. (Jean, XX, 29) » (p. 123) Ô admirable efficacité de la source qui de Deux fait Un et qui établit la paix entre des ennemis ! La source de l’amour peut faire une mens avec un spiritus et une anima ; mais celui-ci, d’une mens et d’un corps, réalise un homme Un. (p. 125) La puissance est la constance de la vertu reçue du Seigneur. (p. 127) Notre chaos est quelque chose d’universel, renfermant en lui tout ce que nous opérons. C’est de son ventre que l’artisan ingénieux doit faire sortir sa matière, la forme, le ciel et les éléments, afin d’en confectionner lesdites médecines. (p. 154) L’homme certes est naturellement Un et on ne le compte pas ; mais surnaturellement, on le compte en deux, à savoir en spiritus et en corps, qui constituent en lui le binaire. Mais à cause de la première corruption, le dernier l’emporte sur le premier, ce qui fait que le spiritus ne parvient à rien produire d’admirable. Pour qu’il le doive dans cette vie, le binaire devra être surpassé par le ternaire, c’est-à-dire que le corps doit se conformer à la nature du spiritus et que le spiritus doit être conjoint au corps, en sorte d’y avoir la paix. Cela fait, le ternaire, né désormais dans l’unité seconde et parfaite, jubile. En effet, desdits deux précédents, un seul troisième s’est fait par leur conjonction. Cette conjonction doit néanmoins se faire par les degrés du quaternaire, c’est-à-dire par la transmutation des éléments en lesquels le corps consiste, en un élément unique et très pur, de la manière suivante : - D’abord, de la terre de ton corps, que se fasse une eau. Autrement dit, que de ton cœur de pierre et inactif, il s’en fasse un qui soit amolli et éveillé à la connaissance de Dieu et de toi-même. Ainsi, les images du spiritus pourront bien s’imprimer en lui, tout comme les caractères d’un sceau dans de la cire. - Ensuite, de cette eau, qu’on fasse un air. En d’autres mots : fais monter en haut dans le ciel, vers celui qui t’a créé, toi [et] ton cœur désormais humilié, à l’instar de l’air qui tend toujours au plus haut. En frappant, prie pour que s’ouvre ton génie, pour comprendre les choses qui sont de Dieu. - Finalement, que se fasse de cet air un feu. C’est-à-dire, que tout désir de ton cœur se convertisse en amour (auquel on compare le feu à cause de son ardeur) de Dieu et de ton prochain ici sur terre, de sorte que cette flamme ne s’éteigne jamais. (pp. 206-207) La plus grande cause de l’erreur est que les sages initiés jadis aux secrets de la nature les ont ou bien totalement tus ou bien enveloppés d’une trop grande obscurité, au point de ne pouvoir être compris avec véracité que par ceux qui leur sont semblables. La philosophie de cette école est secrète et céleste. Si quelqu’un désire sincèrement y acquérir savoir et intellection, il est nécessaire qu’il fuie le tumulte des hommes, qu’il laisse tomber le monde, qu’il contemple le ciel non seulement avec les yeux, mais aussi avec la mens. Le spiritus de Dieu souffle où il veut, il illumine qui il veut, il amène à toute connaissance de la vérité celui qu’il a adombré de son numen. (p. 211) Dans l’élaboration de cette tâche, vous ne devez pas réclamer de moi l’élégance d’un discours cicéronien, car je recherche la mœlle plus que les os morts destinés aux chiens, le noyau plus que l’écorce, et la chose elle-même plus que ses ombres vaines. Je ne prendrai pas le pallium d’or de Pallas pour Pallas elle-même ; et bien plus, sous un vêtement de laine c’est Pallas et non son vêtement que je désire apercevoir, bien qu’il soit inique de la voir nue, à moins peut-être qu’elle-même ne se laisse contempler telle par les intelligences que sa grâce en a rendues dignes. (p. 219) Pour conclure enfin tout de bon, tous les arts provenant de Dieu sont bons. S’il est arrivé quoi que ce soit de mal, tout cela a été semé par le diable qui a presque inversé ces arts dans ce siècle, de sorte qu’ils ne conservent pratiquement rien de leur forme antérieure. Bien plus, les noms même de ces arts ont été inversés, de sorte qu’on appelle la magie, bien que faussement, nécromancie, et la sagesse, philosophie, la sapience, elle, sottise, et vice-versa, et ainsi de suite pour tout le reste. (p. 231) Ensuite arrive le tout grand arcane, c’est-à-dire le mariage supracéleste de l’anima suprêmement purifiée, et lavée par le sang de l’agneau, avec son corps resplendissant, brillant et purifié. C’est le vrai mariage supracéleste qui prolonge la vie jusqu’au dernier jour qui lui a été destiné. C’est donc de cette manière que l’anima et le spiritus du vitriol (qui est son sang) s’accouplent avec leur corps purifié pour être inséparables pour l’éternité. (p. 271) Et tout comme nous voyons qu’un homme et une femme ne peuvent engendrer sans la semence de chacun d’eux, ainsi notre homme le Soleil et sa femme la Lune ne peuvent, sans leur semence et leur sperme à chacun des deux, ni concevoir ni construire quoi que ce soit pour la génération. Nos philosophes en ont conclu qu’un troisième était nécessaire, à savoir la semence animée des deux, de l’homme et de la femme, sans laquelle ils ont jugé que tout leur œuvre était nul et vain. Ce sperme-là est le mercure qui, par la conjonction naturelle des deux corps du Soleil et de la Lune, reçoit en lui la nature de ceux-ci en union. Ce n’est qu’alors, et pas avant, que l'œuvre est apte à la rencontre, à l’entrée et à la génération par la force et la vertu virile et féminine. (p. 284) Dieu découvre aux hommes beaucoup d’autres arcanes de transmutations, qui ne font pas éruption en public à l’instant des manifestations de Lui-même, car, avec la révélation, Dieu donne aussi la grâce de les voiler pour les gens indignes, jusqu’à l’arrivée d’Hélie artiste. Les Paracelsistes discutent de cet Hélie en se demandant qui ce sera. Mais ce n’est pas ce que les autres cherchent qui me retardera ; ce sont seulement ce que sonnent les paroles de l’auteur ; elles rendent mon âme très attentive, pas tant pour moi que pour mes frères. En ce temps-là (dit-il), rien ne sera assez occulte que pour n’être pas révélé. Il faudrait un génie très stupide pour ne pas comprendre, par ces mots, ceux qui précédaient. Qui ignore que ce temps de la révélation toute nue de toutes les choses les plus cachées, ne viendra pas avant la venue de celui qui jugera les pensées tacites des hommes, Jésus-Christ ? C’est lui que Paracelse appelle Hélie artiste, c’est-à-dire la source première et inépuisable de tous les arts et de toutes les choses secrètes. Si quelqu’un s’étonne de ce que, quel que soit le haut degré atteint, les bons arts et les sciences peuvent tous aller toujours plus haut, et que chaque jour on y découvre des choses nouvelles et inouïes, que celui-là considère seulement d’où ils ont émané, et qu’il cesse, en finale, de s’étonner. Car puisque c’est de l’éternelle source et Verbe de Dieu qu’ils tiennent leur être, il est nécessaire qu’ils n’aient pareillement aucun terme ni fin, sauf dans l’éternel Verbe, Fils de Dieu que nous reconnaissons, révérons et adorons comme Hélie artiste. (pp. 235- 236) Si donc Dieu, à travers la nature, se montre à nous si puissant à observer, et si sage, combien se révélera-t-il abondamment plus glorieux à notre mens par son très Saint-Esprit, pour autant que nous le cherchions ! Telle est la voie du salut qui conduit des choses inférieures aux supérieures : c’est de marcher dans les voies du Seigneur, c’est-à-dire d’être versé dans ses œuvres admirables et d’exécuter sa volonté dans la mesure où cela est, doit et peut être en nous. (p. 353) On aperçoit très bien sa vertu de conservation [du sel] dans le fait qu’il conserve très longtemps les viandes mortes de la putréfaction. On pourra facilement juger qu’il les préservera d’autant plus quand elles sont vivantes. (p. 357) |
Achat, Vente, Expertise de livres rares, anciens, épuisés, d'occasion et neufs spécialisés. La Librairie Arca s'inscrit dans la lignée des librairies traditionnelles.
Les visites à la librairie se font uniquement sur rendez-vous, qui seront pris de préférence par e-mail en utilisant ce formulaire ou par telephone au +32 (0)479474542
Nous cherchons en permanence pour achat des livres rares en lot ou à la pièce. N’hésitez pas à nous contacter pour une expertise gratuite.
Nous cherchons en permanence pour achat des livres rares en lot ou à la pièce. N’hésitez pas à nous contacter pour une expertise gratuite.